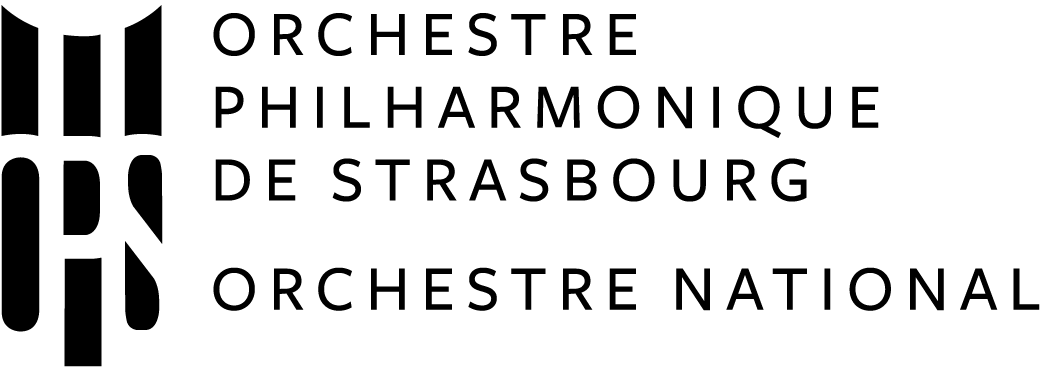Alexandre Tharaud : Récital - le 12 décembre à 17h - Cité de la Musique et de la Danse
Publié le
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 17H
CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Franz Schubert
Impromptus, op.90
Frédéric Chopin
Sonate n°2 « Funèbre » op.35
Franz Schubert - Alexandre Tharaud
Rosamunde D.797 (extrait : Andantino)
Durée du concert : environ 1h15
Artiste en résidence cette saison, le pianiste Alexandre Tharaud évoque le programme de ce récital Schubert / Chopin qu'il donnera à la Cité de la Musique et de la Danse le dimanche 12 décembre. Il livre également quelques réflexions sur son rapport à l’instrument, au public ou encore à la partition. Propos recueillis par Hervé Lévy
Que signifie une résidence dans votre existence artistique ?
Revenir dans un même lieu au cours d’une saison est très rare : la vie de musicien est une suite presque ininterrompue de concerts où on ne voit rien, où on ne rencontre personne [rires]. Cette description est certes un peu caricaturale, mais il n’en demeure pas moins que je voyage sans cesse, même si le verbe voyager n’est pas adéquat : mon corps va de ville en ville, de salle en salle, d’hôtel en hôtel, d’aéroport en aéroport. C’est pour cela qu’une telle résidence est importante : elle me permet de retrouver à plusieurs reprises un public et un orchestre. Un lien se tisse entre nous, mais aussi avec la ville, un lien fait de multiples facettes se déployant à travers concerto, musique de chambre, récital… Il ne s’agit cependant pas uniquement de concerts, mais aussi de rencontres humaines, d’amitié, de partage.
Après un premier concert donné il y a quelques jours, vous proposez un récital où les Quatre Impromptus, op. 90 de Schubert voisinent avec la Sonate pour piano n°2 en si bémol mineur, op 35 de Chopin : qu’ont ces deux pièces à se dire ?
Ce programme parle du destin tragique. Les deux œuvres qui le composent regardent vers le passé, à chaque fois rattaché à quelque chose d’heureux, que ce soient des scènes champêtres, des danses joyeuses, voire même une certaine naïveté de l’enfance. Ces instants de bonheur sont néanmoins fugaces, quelques mesures à peine : chez Schubert, on quitte très vite le majeur pour revenir au mineur, passant de l’allégresse à la tragédie. Ces réminiscences éphémères prennent place dans un aller-retour systématique et mélancolique entre un passé enchanté et un présent sombre, sur lequel plane l’ombre d’un futur à peine esquissé, mais qu’on imagine dramatique.
Retrouvez l'Impromptu n°1 en do mineur Op. 90, D. 899, paru chez Warner/Erato en octobre 2021
La deuxième Sonate de Chopin est du reste dite “funèbre”…
C’est un adjectif qui va bien aux deux pièces ! Au XIXe siècle, le rapport à l’au-delà est très présent dans la peinture, la littérature et la musique. Il s’atténue au XXe pour disparaître au XXIe siècle où la mort est devenue le sujet tabou par excellence de nos sociétés. Quand Chopin l’évoque dans sa sonate “funèbre”, il parle de ce qu’il y a après : le dernier mouvement suggère l’âme s’élevant vers les cieux.
Lorsque vous parlez de la mort, revient à la mémoire un épisode que vous narrez dans Piano intime, recueil d’entretiens avec Nicolas Southon (Philippe Rey, 2013) : tout jeune pianiste, vous aviez un piano que vous surnommiez Bucéphale (comme le cheval d’Alexandre le Grand), dans lequel vous glissiez les faire-part de décès de vos proches…
Quand je suis parti de chez mes parents, je suis arrivé dans un studio du centre de Paris : j’étais toute la journée sur ce piano, un demi-queue Bösendorfer. J’ai eu des morts très tôt dans ma jeune vie d’adulte. Placer ces morceaux de papier dans les entrailles de l’instrument était une manière de rester proche d’eux. Jouer du piano permet de ressusciter ces disparus quelques secondes, quelques minutes, quelques heures… C’est aussi la preuve qu’ils n’ont pas vraiment disparu.
Depuis que vous avez vendu Bucéphale, vous n’avez plus d’instrument à la maison : pourquoi être devenu, « sans piano fixe », comme vous vous décrivez ?
Cela fait en effet presque vingt-cinq ans que je n’ai plus de piano à la maison : auparavant, je passais beaucoup de temps à improviser, à déchiffrer, à butiner… Une manière d’échapper au travail [rires]. Désormais, je joue chez des amis qui me laissent leurs clefs, sur des instruments tous différents, dont les vécus, les qualités, les sonorités sont très divers, m’imprégnant d’atmosphères elles aussi diverses. C’est comme lorsque je vais de salle en salle : tous les pianos sont différents, ils ont chacun un passé. Un piano tout neuf, c’est un piano qui n’a rien à dire. Deux ans au moins sont nécessaires pour qu’il respire, qu’il chante de manière libérée. Un concert n’a rien de commun avec un autre : à chaque fois, il faut apprivoiser le piano très vite. Je ne connais pas encore celui sur lequel je vais jouer ici, mais suis déjà impatient de le rencontrer.
Quelle serait votre définition du verbe interpréter ?
Je me sens d’une certaine manière comme un interprète traduisant en direct d’une langue à une autre et qui va – avec ses propres mots et son ressenti intime – restituer ce que dit une autre personne. Il y a forcément une part de création. Interpréter consiste à recevoir un message du compositeur. Il faut l’avoir lu, travaillé, intégré, peut-être même dépassé, pour être en mesure, au moment du concert, au contact du public, de le restituer à travers notre corps, notre vie avec ses aspects les plus beaux, comme les plus laids. Jouer consiste à accepter qui on est puisque la musique en dit autant du compositeur que de l’interprète.
Avez vous des modèles ?
Pour moi, Rachmaninov est un pianiste phénoménal : l’écouter dans Chopin, par exemple, est un émerveillement. Son jeu est d’une telle transparence ! À l’opposé de ce qu’on imagine du jeu russe. Les écoles – qu’elles soient russes ou françaises –, ça me fait toujours sourire. Son piano est perlé, ciselé à l’extrême. Tout semble tellement facile. À mon avis, il est le plus grand virtuose de l’histoire, parmi ceux qui nous ont laissé des enregistrements. J’aime aussi beaucoup Marcelle Meyer, une pianiste qui donne l’impression de faire sortir la musique de son instrument avec un tel naturel. Quand on sait le travail qu’il y a derrière !
Lâcher prise est essentiel, que ce soit en concert ou au disque…
C’est mon seul but, mais ces instants suspendus sont tellement rares. En concert, on se sent parfois totalement libre et disponible. Le public est là, avec nous. On se laisse alors littéralement jouer, comme si les spectateurs travaillaient pour nous. Mais il fait tenir les rênes [rires] et ces moments de pilotage automatique ne durent que quelques secondes. C’est plus facile lorsque les spectateurs nous entourent, comme à la Philharmonie de Paris : l’interprète se sent environné par une énergie qui vient de toute part, encerclant le piano.
Barbara que vous aimez beaucoup – et à laquelle vous avez rendu hommage avec un disque (Erato / Warner Classics, 2017) – considérait le public comme un « amant à mille bras » : partagez-vous cette vision ?
C’est une très belle expression. Les spectateurs arrivent dans la salle avec leur histoire, apportant quelque chose qui leur est propre au concert. Ils composent une forêt de présences essentielles. Le public c’est toute ma vie. Sur scène, je me sens mieux que nulle part ailleurs. Les émotions sont multipliées par mille. À côté, le reste de la vie apparaît bien fade.
Vous écrivez (Montrez-moi vos mains a été publié chez Grasset en 2017) et composez (le deuxième livre de Corpus volubilis vient de paraître aux éditions Henry Lemoine) : quel est le rôle de ces deux activités dans votre existence artistique ?
Il s’agit d’une manière de passer le temps dans les trains, les avions, les chambres d’hôtel [rires]. Plus sérieusement, j’aime écrire, même si je trouve cela horriblement difficile. Cela me prend beaucoup de temps, mais c’est essentiel dans mon équilibre au quotidien et vient questionner ma pratique pianistique. C’est un plaisir comme celui de composer les pièces de Corpus Volubilis, un hommage au corps, inspiré par la danse (sarabande, valse lente, rumba, mais aussi danses japonaise, guinéenne ou basque). J’imagine ces miniatures dans l’esprit de Mikrokosmos de Bartók et me suis dit qu’il y en aurait cent, réparties en cinq volumes de vingt. Je les ai mises au propre pendant le premier confinement avec l’envie de faire quelque chose sans aucune contrainte, ni de temps, ni de style.