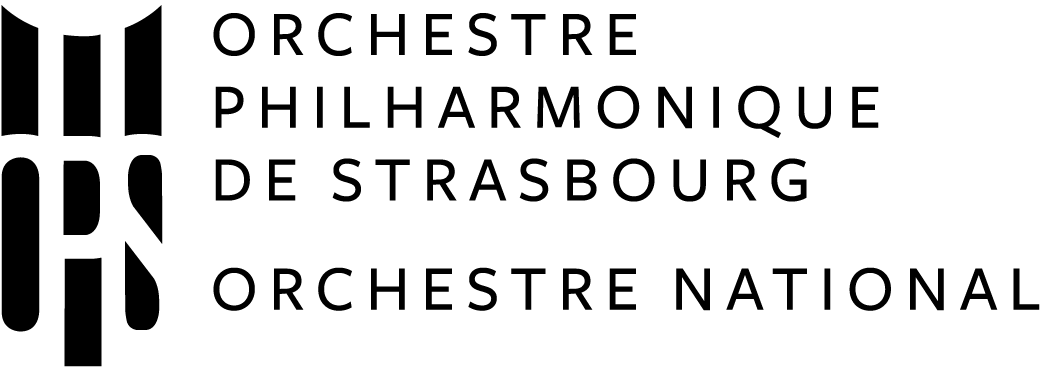David Grimal - Entretien
Publié le
MOZART, UNE INTÉGRALE
jeudi 24 et vendredi 25 février à 20h
Palais de la Musique et des Congrès - Salle Érasme
David Grimal : que notre joie demeure !
Propos recueillis par Hervé Lévy
Fondateur des Dissonances, ensemble à géométrie variable qui rassemble des musiciens issus des plus grandes scènes se réunissant pour expérimenter une autre manière de jouer ensemble, sans chef, le violoniste David Grimal est un artiste singulier. Rencontre autour de l’intégrale des concertos de Mozart avec un virtuose dont les mots nous emportent hors des sentiers battus, qui déclara, il y quelques années : « Le tempo d’une œuvre n’est pas le mouvement métronomique, mais le battement “cardiaque” de l’œuvre, qu’on va avoir en la jouant dans telle ou telle salle, dans tel ou tel état d’esprit. »
Violoniste reconnu vous produisant, comme le veut l’expression consacrée, avec les meilleurs chefs et les plus grandes phalanges, vous décidez de fonder Les Dissonances (reprenant le surnom du Quatuor à cordes n°19 en do majeur K 465 de Mozart) en 2004, un ensemble atypique dans le paysage musical français. À quel besoin répondait ce qui s’apparente un réel changement de cap ?
J’avais un sentiment, même si cela restait diffus, de ne pas trouver assez d’espace – dans la dimension artistique et humaine de mon métier – au sein des structures existantes. Je suis parti marcher dans le désert de Lybie pour penser à cela et, d’une certaine manière, trouver ma place et m’échapper d’un monde de la musique classique très vertical et extrêmement cloisonné par rapport à d’autres formes d’expression artistique, tout du moins. Mon désir était de créer une plate-forme où je pourrais retrouver plus d’espace en m’exprimant plus librement. Les Dissonances sont nées de ce souhait : formation de petite dimension à sa création, elle a grandi au fil des années, jusqu’à pouvoir jouer aujourd’hui les symphonies de Mahler, Bruckner ou Chostakovitch.
Comment décrire la philosophie animant cet ensemble fondé sur un principe d’horizontalité qui vient redéfinir la pratique orchestrale ?
Pour moi, la musique, c’est la relation. Il y a de la musique dans une salle lorsque se crée un lien entre les musiciens, lorsque ces musiciens installent un lien avec le public. La musique c’est ce qui existe dans l’air, entre les êtres.
S’il n’y a pas de chef au pupitre pour les concerts des Dissonances, cela ne veut pas dire néanmoins qu’il s’agit d’un orchestre sans chef…
C’est un chef différent (rires). Bien évidemment, je mène un travail en amont du concert avec les musiciens, construisant tout en collaboration avec eux. Si vous préférez, une certaine verticalité subsiste au sein des Dissonances, mais elle ne s’exerce pas de la même manière que dans une formation traditionnelle : il ne peut exister de communauté sans un leadership fort qui n’est pas synonyme d’autoritarisme, mais de confiance réciproque, de bienveillance… L’exigence n’implique pas forcément la création d’un carcan corsetant les interprètes, un cadre trop serré détruisant toute fertilité. Je cherche en permanence à retrouver cette fertilité essentielle en musique : mon travail s’apparente ainsi à une sorte de permaculture (mode d’agriculture fondé sur les principes de développement durable, respectueux de la biodiversité et de l’humain, NDLR). Il s’agit d’une certaine idée du vivre ensemble fondée sur le respect et, surtout, la joie qui est souvent absente des concerts classiques. On voit malheureusement rarement des musiciens souriants sur scène. La musique consiste avant tout à être heureux !
Comment rendre possible un concert sans chef ?
Tout mon travail de préparation est tendu vers un concert où il n’y a pas de direction, un concert où tous les instrumentistes sont des chefs, si vous préférez. Chez ces derniers, cela créé un désir et une écoute totalement nouveaux ainsi qu’un investissement différent de celui qui est traditionnellement requis. Cette mise en connexion des musiciens entre eux leur permet de redevenir des “musiciens complets” : souvent, les membres des orchestres sont seulement des musiciens lorsqu’ils donnent cours, explorent le répertoire chambriste, etc. mais pas au concert où ils font ce que le chef leur dit de faire. Mon plus cher désir est de les autoriser à sortir de ce rôle d’ouvriers spécialisés, notamment en ayant créé et développé Les Dissonances où chacun possède un espace beaucoup plus important. C’est comme si l’individu était augmenté par la communauté au lieu d’être réduit pour la communauté. Il s’agit d’une expérience d’intelligence collective, car au moment du concert il est impossible de se fier à la baguette de quiconque. Tous – moi y compris – doivent être dans une écoute, une souplesse, une connaissance de la partition bien supérieure à celle demandée dans un orchestre “normal”.
En quoi l’expérience des Dissonances irrigue-t-elle votre pratique lorsque vous venez travailler avec une formation comme l’Orchestre philharmonique de Strasbourg ?
Quand je viens jouer avec un orchestre professionnel, il y a toujours un électrochoc, celui généré par la rencontre entre deux mondes, car je pense désormais être dans un monde très lointain, mon écosystème n’ayant plus grand-chose à voir avec les orchestres traditionnels. Oui, c’est un véritable choc des cultures et des langages, car ma manière de faire n’a rigoureusement rien à voir avec ce que les membres de l’orchestre vivent, semaine après semaine. Passé ce moment de sidération, nous nous apprivoisons mutuellement rapidement. Les musiciens sont obligés de sortir de leur zone de confort, de s’ouvrir les uns aux autres. Sinon ça ne marche pas. Pour certains, il s’agit d’une libération, pour d’autres c’est très difficile…
Quels sont les fruits de ce travail ?
Généralement, ces expériences donnent des résultats incroyables, car les musiciens se dépassent, faisant sonner leur orchestre de manière tout à fait différente, très transparente… Alors que généralement toute l’énergie est braquée sur un chef, elle se diffuse désormais à travers le corps des instrumentistes. Je me souviens d’une violoncelliste de l’Orchestre national de Metz, me disant, des larmes dans les yeux : « Je n’ai pas vécu ça dans mon corps depuis près de quarante ans, depuis que j’ai été étudiante. J’ai eu l’impression que la musique me traversait à nouveau. » C’est une expérience de réappropriation de son métier. Quand un orchestre est au service de la pensée d’un chef, chacun de ses membres abdique une grande partie de sa propre sensibilité se fondant dans une autre vision. Pour ma part, je souhaite que tous trouvent leur place dans un espace qui est celui de l’œuvre. Aucune décision individuelle ne prendra le pas sur un élan collectif, même si je vais donner, au fil des répétitions, le cadre esthétique, les textures sonores, le tempo, les articulations… Mais ces choses sont du ressort de la grammaire. Au moment du concert, nous vivons le moment présent ensemble. Je n’interviens pas. Ce temps m’échappe…
Sur le label que vous avez fondé, vous avez déjà enregistré, en 2015, une intégrale des Concertos pour violon de Mozart avec Les Dissonances qui jouaient sur des violons modernes, mais avec des archets classiques (et utilisaient également des cors naturels, ce qui ne sera pas le cas à Strasbourg, NDLR). C’est ce que vous avez demandé aux musiciens de l’OPS : pourquoi ?
Je trouve ça intéressant pour le langage, car certaines choses, dans le discours de Mozart, deviennent évidentes dès qu’on a un archet plus léger et plus court. Cela permet aussi de faire bouger un peu les lignes… On va voir ce qu’on arrive à tirer de ça, ensemble. Ce concert aura un côté expérimental, mais de toute manière je considère que tous les concerts sont des expériences. Mon but n’est pas un “objet concert” parfait et lisse. Pour moi, cet espace temporel ressemble plus à un ensemble de perspectives. Lorsqu’on on est dans la répétition de quelque chose – ce qui est le cas de l’industrie musicale – cela n’a plus aucun intérêt, du moins à mon avis.
On a le sentiment en effet qu’existe une sorte de standardisation de la musique classique, un même soliste jouant le même concerto avec des orchestres différents, un soir à Londres, le lendemain à Paris ou Berlin, sans jamais vraiment répéter ou aller au fond des choses…
C’est cette absence de créativité que j’ai fui lorsque j’ai créé Les Dissonances. On est plus proche de la variété où un concert ressemble fort à la reproduction d’un disque. En réalité, il s’agit d’une manière de quitter la musique. D’en finir avec elle… La liberté est nécessaire, il est essentiel de s’abstraire du caractère normatif de la musique classique. Récemment, je donnais cours à un étudiant vénézuélien à Sarrebruck (David Grimal est professeur à la Hochschule für Musik Saar, NDLR) : il n’arrivait à rien sur un concerto de Mozart, essayant de tout calculer… Je lui ai dit : « Pourquoi ne jouerais-tu pas Mozart comme tu jouerais une musique de ton pays ? On s’en fiche si tel ou tel est d’accord avec ta vision ! Qui a autorité pour dire comment on doit jouer Mozart dans un monde occidental où pas un orchestre n’est capable de jouer Mozart correctement, c’est à dire avec joie ! » C’est ce qu’on va essayer de faire à Strasbourg…
Vos mots m’évoquent un autre violoniste, Gilles Apap qui me confiait, il y a quelques années : « Dans ma vie, j’ai essayé tant de choses – et me suis fait parfois critiquer pour cela – mais cette liberté est dans mon sang. Il ne faut rien s’interdire. »
Voilà un maître épris de liberté. Gilles Apap est un poète, un funambule, un électron libre merveilleux. Il est plus radical que moi. Radical n’est sans doute pas le bon mot, disons plus excentrique ou… excentré, car je garde, pour ma part, un pied dans l’institution, parce que je pense que c’est ainsi, de l’intérieur, qu’il est possible de faire bouger les lignes.
Pour en revenir à cette intégrale des concertos de Mozart, nous évoquions l’enregistrement réalisé avec Les Dissonances : vous aviez alors demandé à Brice Pauset de composer des cadences originales pour chacun des concertos…
On les retrouvera à Strasbourg. C’était important de demander cela à un compositeur d’aujourd’hui plutôt connu pour son écriture abstraite et complexe. On ne peut pas dire qu’il fasse partie de néo-tonaux (rires). Reste que Brice Pauset est un grand spécialiste de la musique ancienne, un élève de Gustav Leonhardt qui construit ses instruments lui-même et un claviériste hors pair. Nous avons souvent travaillé ensemble puisqu’il a imaginé une cadence pour moi dans le concerto de Beethoven ou composé Kontrapartita (crée en 2009 à l’Opéra de Dijon par David Grimal).
Comment percevez-vous cet ensemble de cinq concertos écrits par Mozart en un temps très bref, au cours de l’année 1775 vraisemblablement ?
Mozart a été meilleur dans ses concertos pour piano (rires), mais ce qui est fou avec ces cinq concertos est de voir l’écriture se complexifier, du premier, encore très italien, au cinquième, plein de profondeur. On a le sentiment que Mozart secoue le modèle, voit jusqu’où il peut aller, puis abandonne le genre : c’est comme s’il avait fait le tour de la question, mais avouons qu’il s’est bien amusé en créant ce joli collier de perles plein de feu, de grâce et de légèreté. Ces œuvres servent souvent de pièces de concours pour rentrer dans les orchestres. Quel paradoxe extraordinaire ! Si Mozart avait su qu’on imposerait cette fonction à ces musiques, il aurait immédiatement brulé les partitions, car elles incarnent exactement le contraire.
Vous jouez le Stradivarius “Ex-Roederer” de 1710 fabriqué pour le Roi d’Espagne et ramené comme butin de guerre par un lieutenant de Napoléon (qui lui donna son nom), violoniste à ses heures perdues. Ensuite, il fut acheté en 1923 par un Arménien, manager de concert, pour la femme qu’il aimait. Que pouvez-vous nous dire de cet instrument qui vous accompagne depuis longtemps maintenant ?
C’est un violon merveilleux et extrêmement racé, mais assez capricieux ; il me permet parfois de m’envoler, mais me dit aussi de temps à autre qu’il vaudrait mieux ne pas y aller ! Nous avons une relation d’amour complexe. Je ne sais pas ce qu’il a actuellement… Ce sont sans doute les changements de saison (rires).
Itzhak Perlman affirmait : « Si un violoniste est encore capable de jouer après l’âge de quarante ans dans cette carrière, c’est un miracle ! » Vous qui venez de fêter votre quarante-neuvième anniversaire avez bifurqué à temps…
En effet, je ne me suis jamais autant senti en harmonie avec la musique qu’aujourd’hui. C’est l’avantage d’avoir pris des chemins de traverse. De toute manière, je n’aurais pas pu faire autrement… Cet épuisement évoqué par Itzhak Perlman est celui des tournées interminables avec des orchestres pour satisfaire des agents et des maisons de disques. C’est très mauvais pour la santé des violonistes certes, mais avant tout pour celle de la musique !