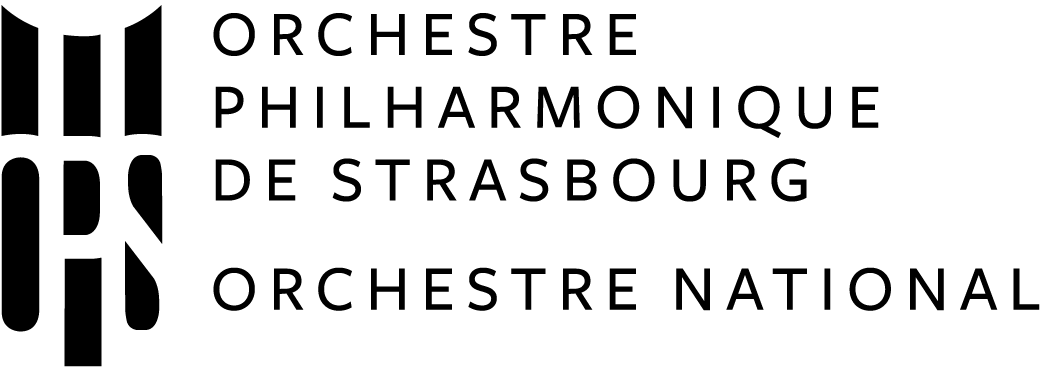Du jazz, mais pas trop !
Publié le
Clarinettiste solo de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, Sébastien Koebel interprète le Concerto d’Aaron Copland dans un programme aux tonalités américaines. Entretien autour d’une œuvre néo-classique où sont incorporés de multiples éléments jazzistiques.
Comment avez-vous découvert le Concerto pour clarinette de Copland ?
J’ai eu le coup de foudre pour cette œuvre en entendant mon professeur du Conservatoire de Paris, Richard Vieille, l’interpréter en concert : je ne la connaissais pas, mais ma culture, à l’époque, ne devait pas être énorme [rires]. Un peu plus tard, on m’a offert le disque… Depuis, le Concerto m’accompagne : je l’ai, par exemple, joué pour mon Prix au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en 1999.
Quels sont les enregistrements qui vous ont marqué ?
Le premier disque que j’ai découvert, enregistré par Philippe Cuper : il ne devait pas y en avoir trente-six à l’époque [rires]. Il y a aussi les deux enregistrements de Benny Goodman, le dédicataire de l’œuvre. Celui qu’il a gravé avec Copland au pupitre du Columbia String Orchestra est extraordinaire. On sent qu’il se passe quelque chose entre eux. Benny Goodman, qui était pourtant un jazzman au départ, ne va pas trop loin dans le côté jazzy, contrairement à certains autres qui poussent le bouchon… jusqu’au mauvais goût [rires]. La difficulté de cette partition est là : il faut qu’elle swingue, mais pas trop !
Comment décririez-vous ce Concerto ?
Ce mélange entre néo-classicisme et jazz est extrêmement délicat, mais le plus étonnant est de faire du jazz sans pupitre de percussions, ni de cuivres, dans un orchestre à cordes accompagné d’une harpe et d’un piano ! La percussion est présente quand les contrebassistes font du slapping et, dans une moindre mesure, grâce à une technique d’essence similaire à la harpe.
On y trouve aussi quelques réminiscences sud-américaines…
Des traces éparses sont en effet perceptibles, rappelant qu’à l’époque des premières esquisses de la partition, en 1947, Copland était à Rio de Janeiro. Mais le plus important est sans doute la structure en deux mouvements reliés par une cadence : si le premier est très « sage », le second part dans tous les sens, et l’instrument y est poussé à ses extrêmes.
Berlioz, dans son Traité d’instrumentation et d’orchestration affirmait du reste que la clarinette est « celui de tous les instruments à vent, qui peut le mieux faire naître, enfler, diminuer et perdre le son ». Est-ce qu’il s’agit d’une partition difficile ?
Ce n’est pas du point de vue technique qu’elle est la plus difficile, mais stylistiquement, comme on l’évoquait il y a quelques minutes : il ne faut pas lâcher les chevaux, ne pas aller trop loin.
Comment est-ce qu’on se prépare à un tel concert ?
On travaille beaucoup [rires] ; c’est une préparation mentale, physique et musculaire… J’ai commencé à le travailler il y a trente ans, mais depuis quelques mois, il est présent à chaque moment de la journée.
Comment définir le verbe « interpréter » ?
Il est essentiel de tenter d’entrer dans la tête du compositeur, c’est pourquoi les deux enregistrements de Benny Goodman sont si importants, puisqu’il était en contact direct avec Copland. La partition est essentielle, c’est la source première… Dès que je m’en écarte, je suis rattrapé par le texte. Je pars de là, mais il y a de la place pour remettre les choses en questions [rires].
Est-ce que ce type de concert, où vous êtes soliste et jouez avec vos collègues, est important dans votre vie musicale ?
C’est toujours plus délicat de jouer devant sa famille, que de jouer à l’autre bout du monde avec des musiciens qu’on ne connaît pas, avec un public qu’on ne connaît pas, dans une salle qu’on ne connaît pas. C’est forcément un challenge et une remise en question : on se retrouve à nu, complètement à nu… Pour moi, donner ce concerto est néanmoins avant tout un grand moment de plaisir !
Propos recueillis par Hervé Lévy