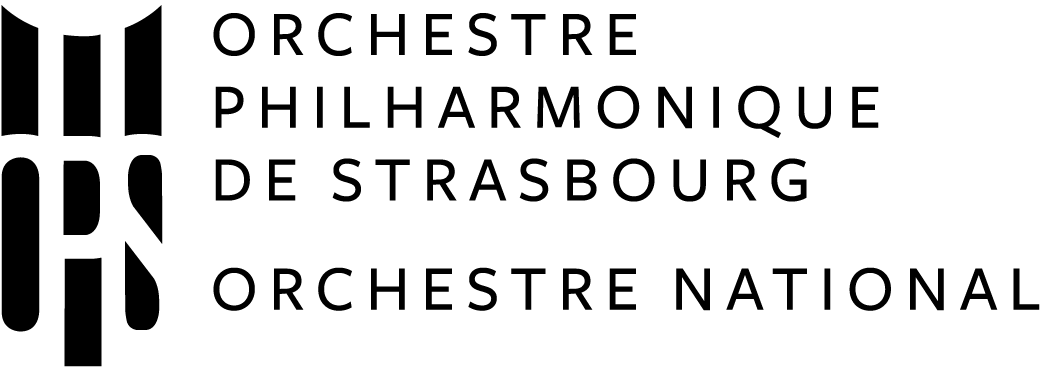Entretien : Alexandre Kantorow, l'art du lâcher prise
Publié le
Alexandre Kantorow, l’art du lâcher prise
En 2019, à l’âge de 22 ans, Alexandre Kantorow a été le premier pianiste français à remporter la Médaille d’Or du mythique Concours Tchaïkovski – succédant à Mikhaïl Pletnev, Grigory Sokolov ou Boris Berezovsky – ainsi que le Grand Prix (décerné seulement trois fois, auparavant). Il revient à Strasbourg avec le rare deuxième concerto du compositeur russe qu’il avait interprété en finale. Le virtuose explique les raisons de ce choix, revenant sur les liens qui l’unissent à son auteur et explicite son rapport à l’instant décisif du concert.
La saison passée, vous avez interprété le Concerto n°2 de Saint-Saëns à Strasbourg (31 mars & 1er avril 2022) : quel souvenir gardez-vous de ces soirées ?
J’ai la chance d’avoir beaucoup d’amis de ma génération dans les orchestres : à Strasbourg, je connais certains musiciens depuis le Conservatoire. J’étais très heureux de les retrouver. Jouer ensemble m’a permis de sentir leur engagement, leur désir d’être ensemble. J’ai le sentiment que l’OPS est en pleine ascension, et c’est un plaisir de revenir !
Vous allez interpréter le Concerto pour piano n°2 de Tchaïkovski : que représente pour vous le compositeur, auquel votre nom est désormais lié ?
Tchaïkovski incarne une forme d’idéal de mélodie, de simplicité dans le romantisme, toujours associé aux tourments de l’artiste qui va les exprimer dans sa partition. Il y a de cela chez lui, bien sûr, mais aussi une limpidité et une évidence. Pour le compositeur, transmettre une émotion ne passe pas forcément par une plongée dans son âme torturée. C’est pour cela qu’il nous touche en plein cœur, parlant très directement à tous, même ceux qui découvrent ce répertoire.
Pourquoi avoir choisi de donner à Strasbourg ce deuxième concerto, qui n’est pas le plus populaire, mais que vous avez interprété en finale du Concours Tchaïkovski ?
En préparant le concours, j’avais commencé à travailler le premier, mais je me suis rapidement embourbé parce que l’œuvre est tellement connue : avant d’avoir ouvert la partition, j’avais ainsi déjà mille versions en tête, dont je n’arrivais pas à me détacher [rires]. J’ai donc décidé d’aller vers le deuxième, qui m’apparaissait comme un espace de liberté, un territoire inexploré : même s’il est beaucoup joué en Russie, il l’est bien moins ailleurs. En le travaillant, j’ai rapidement eu le sentiment que Tchaïkovski nous emportait encore plus loin dans son univers intime que dans le premier concerto. Bien évidemment, il est plus long, peut-être plus ingrat dans sa forme. Il se répète parfois aussi, mais se révèle tellement plus touchant, plus personnel, que j’ai envie de le défendre, histoire de le réhabiliter.
Trois versions de l’œuvre existent : la partition originelle de 1881, celle qui a été allégée par son auteur en 1887 et une édition posthume intégrant des arrangements d’Alexandre Siloti : laquelle avez-vous choisie ?
Je privilégie la première, avec son deuxième mouvement si singulier, où le piano reste longtemps silencieux avant de prendre part à un « triple concerto » avec le violon et le violoncelle. Cette version a quelque chose d’unique. Même si ce concerto, à la fois virtuose et symphonique, est atypique par rapport à l’idée traditionnelle qu’on se fait du genre, c’est justement cette étrangeté qui fait toute sa saveur !
Pour en revenir au Concours Tchaïkovski : quelques années plus tard, qu’en reste-t-il ?
Cela paraît à la fois très loin et très proche. Ce qui m’a fait le plus peur juste après est lié à tout ce que ce qu’il représente sur le plan symbolique. C’était comme un poids sur mes épaules : ma vie a changé du jour au lendemain, les engagements se multipliaient de manière exponentielle… Le coup d’arrêt de la Covid-19 m’a paradoxalement permis d’atterrir, de savoir ce que je voulais et de réfléchir sur les équilibres nécessaires dans l’existence d’un soliste. Remporter ce concours n’a jamais été une finalité pour moi : il a été un commencement, comme s’il marquait le passage à l’âge adulte [rires].
Quelles sont vos figures tutélaires dans l’histoire du piano ?
Il y en a beaucoup ! Le premier pianiste que j’ai beaucoup écouté était György Cziffra : je pense qu’il y avait une part de fascination un peu idiote d’adolescent pour son goût du risque, sa volonté de transgresser les normes et sa virtuosité presque sans limites. En le réécoutant aujourd’hui, je m’aperçois néanmoins qu’il constitue un magnifique modèle d’intuition musicale. Derrière les apparences, il y a une science du timing et du son incroyable. Depuis, il y en a eu beaucoup d’autres comme Vladimir Sofronitsky – pour son côté instinctif, car c’est au moment du concert qu’il se délie de tous ses réflexes pris en travaillant – ou Martha Argerich, également extraordinaire en termes d’intuition musicale. Pour moi, Mikhaïl Pletnev est aussi un modèle de créativité : dès que j’ai une panne d’inspiration, je vais l’écouter, ce qui me permet d’ouvrir des champs nouveaux, tant son vocabulaire sonore semble illimité.
Vous avez étudié avec la grande pédagogue qu’est Rena Shereshevskaya : a-t-elle une place particulière dans votre existence ?
Ses priorités musicales étaient très différentes de celles auxquelles j’étais habitué quand je l’ai rencontrée. D’un côté, son enseignement est très traditionnel, celui d’une immense pédagogue qui connaît des choses incroyables sur des détails très concrets de pédale, de bras… De l’autre, elle a cette folie un peu mystique lui permettant d’avoir chaque semaine une vision différente et argumentée sur la même œuvre. C’est extrêmement stimulant, ouvrant sur des questionnements nouveaux. Elle vous appelle à deux heures du matin pour donner un conseil ou parler de symbolisme. Pour elle, tout, ou presque, descend de Bach : si Beethoven répète quatorze fois un la bémol dans sa Sonate n°31, c’est qu’il se réfère au chiffre de son prédécesseur1 et il y a des enseignements à en tirer ! Rena Shereshevskaya m’a ouvert les portes de mondes nouveaux et je continue à la voir aujourd’hui lorsque j’aborde une œuvre.
Quelle a été la place de votre père, Jean-Jacques Kantorow (violoniste et chef d’orchestre) dans votre formation ? Le considérez-vous comme un de vos professeurs ?
Je ne dirais pas qu’il a été un professeur ou alors un professeur inconscient [rires]. Petit, je ne voulais pas entendre ma mère (également violoniste professionnelle) ou mon père me donner un conseil. J’étais fermé et voulais que mon professeur me dise les choses. Mais je les entendais travailler toute la journée ! Rapidement, nous avons néanmoins joué ensemble, pour le plaisir.
Vous avez gravé plusieurs disques avec lui, dont une intégrale des concertos de Saint-Saëns (BIS, 2019 et 2022), où il dirige le Tapiola Sinfonietta. J’ai lu que vous aviez aussi enregistré les trois sonates de Brahms ensemble : quand seront-elles publiées ?
Nous les avons enregistrées, parce que mon père arrête le violon et que nous avions envie de partager un moment : l’objectif premier n’est pas de les publier. Peut-être le seront-elles un jour, peut-être seulement une, peut-être aussi resteront-elles dans le domaine de l’intime… Nous sommes en train d’y réfléchir, mais c’était une belle manière de marquer son pot de départ [rires]
Vous avez aussi joué le deuxième concerto de Brahms en finale du Concours Tchaïkovski : quelle importance revêt le compositeur ?
J’ai découvert cette pièce à douze ou treize ans : cela a été une véritable révélation. Je l’ai écoutée un nombre incalculable de fois avant de la l’interpréter sur scène à dix-sept ans, pour la première fois. Ce goût pour le deuxième concerto m’a donné le goût pour son auteur. J’aime éperdument les équilibres à l’œuvre chez Brahms, entre une chaleur proche du cœur et un intellect extrêmement délicat. Je continue à explorer l’œuvre de mon « compositeur de cœur » et je pense que je ne m’en lasserai jamais.
À vous voir sur scène, on a le sentiment d’un accomplissement où le lâcher prise à une part importante…
Beaucoup parlent, comme vous venez de le faire, de lâcher prise, d’insouciance même, mais en réalité ce n’est pas toujours le cas [rires]. Avant le concert, je n’ai pas de rituel à proprement parler, mais j’aime écouter de la musique pour me mettre dans l’ambiance : échauffer ses oreilles est aussi important qu’échauffer ses mains ! Quand les choses se passent bien, seules la musique et l’adrénaline existent. Les questionnements sur la partition ou l’acoustique de la salle, les éléments abordés en répétition… doivent rester en coulisses, sinon mes bras ont tendance à se bloquer, à se fermer. Quand cela fonctionne – et ce n’est pas tous les jours –, je me sens comme transporté au cœur du son, dans une zone bizarre où tout semble possible, où mon cerveau est à distance. C’est peut-être cela le lâcher prise que vous évoquez.
La saison passée, vous aviez donné le Sonnet de Pétrarque n°104 de Liszt et Vers la Flamme de Scriabine après le concerto de Saint-Saëns. Que représentent les bis pour vous ?
Je ne suis pas certain que chaque œuvre appelle un bis sur le plan de l’émotion musicale, mais ce moment de partage venant prolonger le concert est essentiel. Parfois, la tête n’est pas d’accord avec le cœur, mais c’est lui qui l’emporte puisque j’ai du mal à m’empêcher de faire un bis. Certains sont préparés d’avance, mais la plupart viennent avec l’envie du moment, en fonction de l’ambiance de la soirée ou des échanges avec les musiciens de l’orchestre. Le bis doit rester spontané, cela fait partie de son charme.
Propos recueillis par Hervé Lévy
1 En fonction de la place de la lettre dans l’alphabet : B=2, A=1, C=3, H=8, donc BACH=14