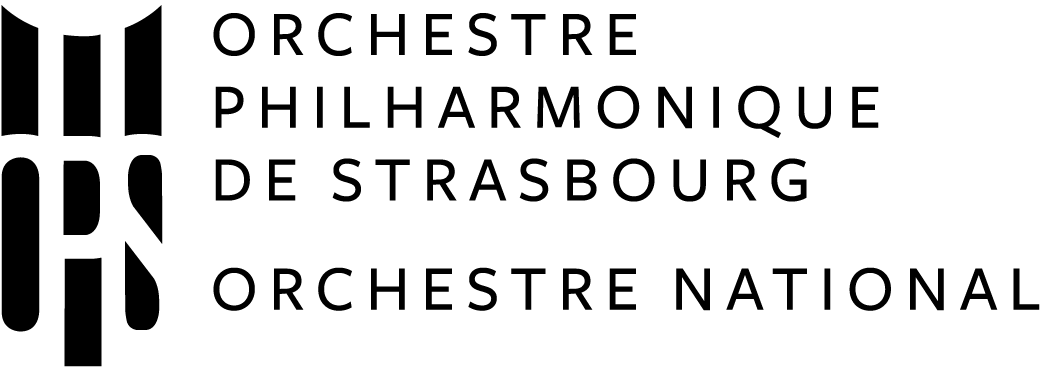Entretien avec Sol Gabetta
Publié le
RÉSONANCE DES MYTHES
jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20h
Palais de la musique et des congrès - Entrée Érasme
RICHARD STRAUSS
Don Juan
WITOD LUTOSŁAWSKI
Concerto pour violoncelle
KAIJA SAARIAHO
Ciel d’hiver
RICHARD STRAUSS
Mort et Transfiguration
Hannu LINTU direction, Sol GABETTA violoncelle
Sol Gabetta, une quête de l’intensité
Propos recueillis par Hervé Lévy
Elle avait interprété le Concerto pour violoncelle d’Elgar avec l’Orchestre en octobre 2011 : Sol Gabetta est de retour à Strasbourg, tout juste auréolée du titre de "soliste instrumental de l’année" aux Victoires de la musique classique 2022. La virtuose arrive en voisine, puisqu’elle habite à Bâle et a passé une bonne partie de son enfance en Alsace, à Saint-Louis. « Ici, je me sens comme à la maison », annonce-t-elle d’emblée avant de développer les contours de sa philosophie musicale.
Vos deux maîtres, Ivan Monighetti et David Geringas, sont des élèves de Mstislav Rostropovitch : vous sentez-vous appartenir à ce qu’il est convenu d’appeler l’école russe de violoncelle ?
Sur une planète mondialisée, on pourrait avoir le sentiment que ces écoles ne sont plus qu’un lointain souvenir, mais leur existence se manifeste néanmoins, par exemple, dans la manière de jouer des notes forte : l’école française est très délicate, l’école russe un peu plus brute (rires). Dans mon approche physique de l’instrument, je suis très “russe”, mais le fait d’avoir eu la chance, très jeune, vers vingt-deux, vingt-trois ans, de travailler avec des personnalités de l’univers baroque – comme Giovanni Antonini et son ensemble Il Giardino Armonico – a fait évoluer ma manière de voir la musique.
Cela vous a permis de trouver une voie plus personnelle…
Appartenir à une quelconque école n’était pas mon désir. J’ai ce côté un peu individualiste (rires). Je me suis aussi intéressée à l’école française – la pureté de Pierre Fournier ou André Navarra – même si ma technique d’archet est très différente. Chez moi, le poignet bouge beaucoup, chez d’autres – à l’image d’Heinrich Schiff, par exemple –, pas du tout : ils ont la main droite bien posée, comme à l’époque de Bernhard Romberg, faisant le moins de mouvements de poignet possible. Mon jeu est plus physique, c’est comme si je lançais tout mon corps pour créer un son plus profond. Il m’apparaît essentiel d’oublier qu’il y a un corps d’un côté et le violoncelle de l’autre : l’interprète et l’instrument ne doivent faire qu’un pour que l’intensité artistique de la partition s’exprime.
Comment abordez-vous une partition nouvelle ? Toute œuvre a des versions de référence (Jacqueline du Pré pour le concerto d’Elgar, Mstislav Rostropovitch ou Natalia Gutman pour ceux de Chostakovitch, par exemple) : les écoutez-vous ?
C’est merveilleux d’avoir la possibilité découvrir les grands interprètes qui ont expérimenté une partition avant nous. Pour le concerto de Lutosławski, nous avons la chance d’avoir ce très beau disque où il est joué par Rostropovitch aux côtés de Tout un monde lointain de Dutilleux (avec l’Orchestre de Paris dirigé par Serge Baudo ; enregistrement réalisé en 1975 disponible chez Warner classics, NDLR) : tous les trois sont réunis sur la pochette. Rostropovitch est le dédicataire des deux partitions et connaissait leurs auteurs. Il est sans doute plus proche d’une certaine “vérité” que moi. Mon mode d’appréhension est certes d’écouter ces références, mais de m’en libérer pour être la plus sincère possible en me nourrissant de toute l’œuvre du compositeur, de sa musique de chambre à des œuvres symphoniques.
Que pouvez-vous nous dire du Concerto pour violoncelle de Lutosławski que vous interprétez à Strasbourg ?
Je trouve fascinante cette combinaison entre une structure très mathématique et un côté émotionnel. Plus émotionnel, c’est impossible. Il est néanmoins difficile pour moi de vous parler de cette œuvre maîtresse que j’ai jouée pour la première fois hier soir devant un public (l’entretien s’est déroulé le 1er avril 2022, NDLR) avec les Bamberger Symphoniker et Krzysztof Urbański. J’en aurai une réelle vision après l’avoir expérimentée dans la durée : l’œuvre se sera alors développée, devenant comme une partie de moi. C’est d’autant plus complexe de l’évoquer que j’ai été contrainte de la travailler sans mon instrument au cours des derniers mois, suite à une blessure à la main, et que je suis entrée dedans par le biais de la partition, menant un travail plus mental que physique.
Si votre répertoire est marqué par de forts contrastes – d’Il Progetto Vivaldi à une véritable appétence pour la musique contemporaine – on a néanmoins le sentiment que la volonté de faire mieux connaître des artistes oubliés est un de ses fils rouges…
Il est essentiel, par exemple, de faire découvrir tout un pan de la musique pour violoncelle du XIXe siècle. On y croise des figures aussi passionnantes que Lisa Cristiani, une virtuose morte à vingt-cinq ans, personnage énigmatique qui fascina Mendelssohn (il lui dédia sa Romance sans paroles opus 109 pour violoncelle et piano, NDLR) et partit pour la Russie pour un long voyage jusqu’en Sibérie dont elle ne revint pas. Au niveau des compositeurs, je m’attèle aux pièces d’Adrien-François Servais qui fut aussi un interprète de haut vol : c’est un répertoire d’une telle difficulté nécessitant une virtuosité incroyable, mais l’enjeu n’est pas la technique, plutôt la manière de l’utiliser pour rendre justice à des partitions appartenant véritablement au registre du bel canto ! Il faut oublier qu’on est un instrumentiste pour se mettre dans la peau d’un chanteur d’opéra.
En concert, dans quelle mesure vos liens avec l’orchestre et le chef se nourrissent-ils de votre intense pratique chambriste ?
Je pense que l’approche chambriste m’a beaucoup aidée : je recherche toujours cette même intimité, luttant parfois avec certains chefs qui veulent toujours que le violoncelle joue plus fort. Pus fort que quoi ? (rires). Très jeune, j’ai eu envie d’autre chose : attirer les spectateurs avec des sonorités différentes. Plus on donne de la puissance, plus on donne de la vitesse, moins le public est sensibilisé à une recherche des finesses et de l’intensité dans les mouvements lents et les notes les plus délicates. L’intervalle dynamique entre forte et pianissimo est très ample : mon intérêt musical est de l’exploiter au maximum pour gagner des richesses sonores et dynamiques permettant d’agrandir au maximum l’exploration interprétative d’une œuvre. Il ne faut pas croire que la musique manque de force si elle devient douce. La difficulté consiste à conférer de l’intensité à un pianissimo : c’est aussi ce que j’essaie d’apprendre à mes élèves (Sol Gabetta enseigne à l’Académie de Musique de Bâle depuis 2005, NDLR).
On découvre aussi cette appétence pour la musique de chambre dans votre discographie : que pouvez-vous dire de votre dernier disque Sol & Pat (Alpha classics, 2021), véritable hymne à l’amitié gravé avec la violoniste Patricia Kopatchinskaja ?
Patricia fait partie des artistes avec lesquels je joue depuis de longues années : j’avais vingt-deux ans lorsque nous nous sommes rencontrées. C’est comme Bertrand Chamayou : nous avons joué ensemble pour la première fois à dix-sept ans, à une époque où nous n’avions presque pas d’engagements. Le disque que vous avez évoqué n’était pas réalisable avec quelqu’un d’autre : je ne peux pas m’imaginer deux personnes qui se rencontrent pour un tel projet… Il faut tant de travail, de connaissance mutuelle, de complicité pour aborder la complexité de ce répertoire composé de morceaux qui nous inspirent (allant de Carl Philipp Emanuel Bach à Jörg Widmann, en passant par Ravel, Xenakis, Ligeti, Kodály, NDLR). Pour que deux personnes ne fassent qu’une sur scène ou au disque, cette histoire commune est indispensable et irremplaçable.
Vous jouez un violoncelle de Matteo Goffriller de 1730 et le “Bonamy Dobree-Suggia” d’Antonio Stradivarius de 1717 : comment choisissez-vous l’instrument le plus adapté à chaque concert ?
J’avais joué une première fois le Stradivarius à dix-sept ans et j’ai eu la chance de le retrouver il y a peu (il lui est gracieusement mis à disposition par la Fondation Habisreutinger, depuis 2020, NDLR). Il possède une pureté extraordinaire dans le son ; on dirait qu’il se déploie sur de la neige ! J’ai enregistré un disque – qui n’est pas encore paru – avec François-Xavier Roth et Les Siècles, utilisant ce Stradivarius et des cordes en boyaux, dédié au répertoire romantique français, avec les deux concertos de Saint-Saëns et celui de Lalo. Il a une telle beauté dans les couleurs, une telle finesse… Avec lui, je projette aussi un CD autour du répertoire pour violoncelle et piano de Mendelssohn avec Bertrand Chamayou. J’ai ainsi décidé que toutes les œuvres que je joue avec des cordes en boyaux le seront avec le Stradivarius, réservant le Goffriller aux autres, comme ce concerto de Lutosławski : cet instrument permet une intensité supérieure, car il possède un côté “tigre” qui va rugir… Le violoncelle est comme un “récitant” : le Stradivarius a la douceur des voyelles, le Goffriller la puissance des consonnes.